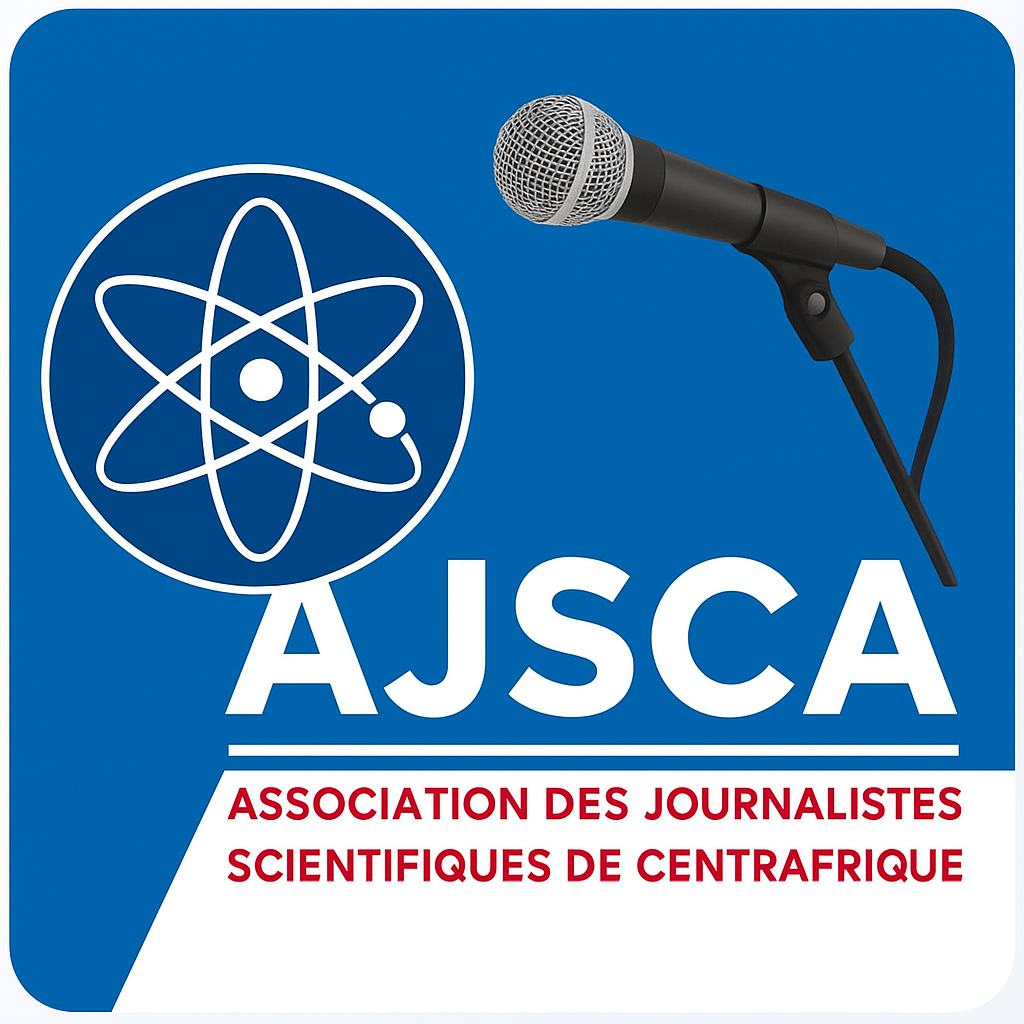Dans les quartiers de Bangui, de Bossangoa ou de Berbérati, le chien fait partie de la vie quotidienne. Il garde la maison, joue avec les enfants, suit son maître dans la rue ou se repose près du foyer. Cette proximité est chaleureuse, familière, presque inséparable de notre manière de vivre. Pourtant, derrière cette relation harmonieuse se cache parfois une menace silencieuse : la rage.
La rage est une maladie virale grave qui se transmet souvent par la morsure d’un chien infecté. Elle progresse lentement dans le corps sans se faire remarquer. Une simple morsure, parfois jugée insignifiante, peut être le point de départ d’un danger mortel. Pendant plusieurs jours ou semaines, rien ne laisse penser qu’un virus se développe. Puis, soudain, les symptômes apparaissent : fièvre, douleurs, agitation, difficultés à avaler, peur de l’eau, paralysie. À ce stade, il n’existe plus aucun traitement. C’est cela qui rend la rage si redoutable.

« La rage tue parce que les gens arrivent à l’hôpital trop tard », explique calmement le Dr Valentin Nebanga, Chef de la Promotion de la Santé et de la Population. Le vétérinaire Dr Ben David Issoula Songuet partage le même constat. Pour lui, le problème vient surtout du manque de vaccination des chiens. Dans de nombreuses familles, le chien n’est pas suivi, parfois laissé sans soins ou livré à lui-même dans la rue. Tant que ces animaux ne sont pas vaccinés, les communautés restent exposées.
Pourtant, il existe un geste simple, accessible à tous, qui peut sauver une vie. Lorsqu’une morsure survient, il faut laver immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon pendant au moins quinze minutes. Ce lavage permet d’éliminer une grande partie du virus avant qu’il ne pénètre trop profondément dans l’organisme. Ensuite, il faut se rendre rapidement au centre de santé pour recevoir le vaccin. Ce geste, souvent méconnu, est essentiel.
 La prévention passe aussi par la vaccination des chiens. Un chien vacciné ne transmet pas la rage. Le protéger, c’est protéger la famille et le voisinage. « Protéger les chiens, c’est protéger les familles », rappelle le Dr Issoula. C’est une responsabilité partagée, un devoir de solidarité. Chacun peut contribuer : les propriétaires en vaccinant leurs animaux, les autorités en organisant des campagnes, les communautés en parlant, en sensibilisant, en transmettant le bon réflexe.
La prévention passe aussi par la vaccination des chiens. Un chien vacciné ne transmet pas la rage. Le protéger, c’est protéger la famille et le voisinage. « Protéger les chiens, c’est protéger les familles », rappelle le Dr Issoula. C’est une responsabilité partagée, un devoir de solidarité. Chacun peut contribuer : les propriétaires en vaccinant leurs animaux, les autorités en organisant des campagnes, les communautés en parlant, en sensibilisant, en transmettant le bon réflexe.
La rage n’est pas une fatalité. C’est une maladie que l’on peut empêcher. Lorsque les familles agissent rapidement et que les chiens sont vaccinés, la mort peut être évitée. Il suffit parfois d’un geste, d’une parole transmise, d’une vigilance partagée pour sauver une vie.